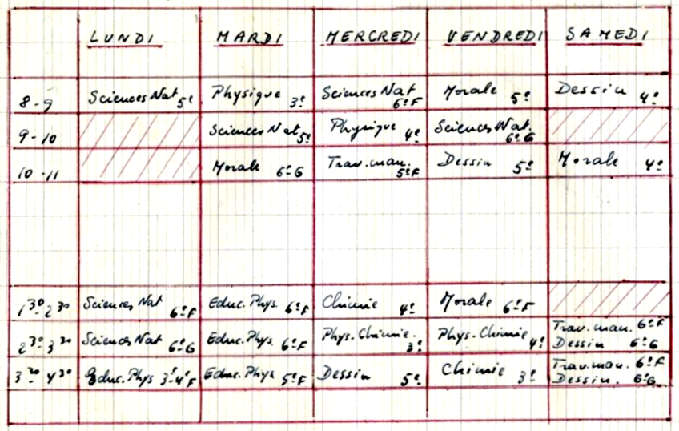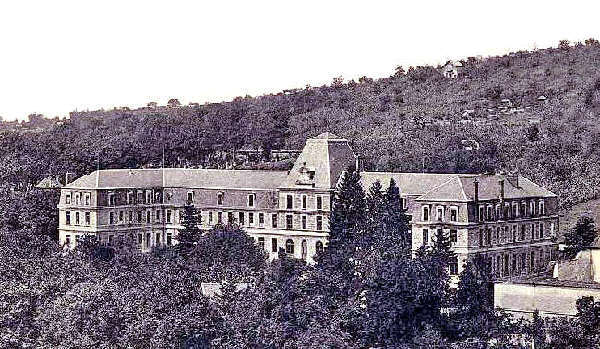|
Le
concours d'entrée à l'École Normale : l'écrit. |
|
Les
événements de la deuxième quinzaine de juin furent parmi les plus émotionnants
et les plus lourds de conséquences de ma vie. L'écrit du concours
d'entrée à l'École Normale était fixé au 5 juin. Je voyais
approcher cette date avec une impatience mêlée de crainte. Après des
mois de travail opiniâtre, j'avais hâte de
me mesurer enfin à mes concurrents, mais j'appréhendais les
contraintes matérielles de l'examen. Celui-ci avait lieu au chef-lieu
du département, une ville où je n'étais jamais allé et qui était
difficilement accessible depuis mon village. Bien que n'étant située
qu'à une soixantaine de kilomètres, il fallait pour l'atteindre
d'abord une heure d'autocar, puis une demi-heure de train, et les
horaires de ces transports ne permettaient pas d'arriver pour le début
des épreuves à neuf heures du matin. De plus, l'écrit se déroulait
sur deux jours. J'étais apeuré à l'idée de passer la nuit dans la
ville car je n'avais jamais dormi en-dehors de la maison paternelle.
Heureusement, nos professeurs nous prenaient en charge : Monsieur
Heldgraf nous conduirait avec sa voiture sur le lieu de l'examen tandis
que Monsieur Elsener s'occuperait du logement.
|
 |
La
veille du concours, un dimanche, fut un jour de tension. Je tournais en
rond, les heures ne passaient pas. Monsieur Heldgraf nous avait
déconseillé les révisions de dernière minute. "Lisez plutôt
quelques pages d'une oeuvre littéraire pour imprégner votre esprit de
beau langage." avait-il suggéré. Aussi, je lus deux chapitres de
"Terre des hommes" de Saint-Exupéry. J'avais du mal à m'y
plonger vraiment, ma pensée revenait sans cesse à l'examen. Pourtant,
c'était bien d'actualité de lire sous la plume de l'écrivain aviateur
: "L'homme
se découvre quand il se mesure avec l'obstacle." L'obstacle était
devant moi, pourvu que je n'aille pas me crasher ! |
 |
|
Tôt
le lendemain, Monsieur Heldgraf fit le ramassage des quatre candidats
garçons du CEG et nous fonçâmes vers le chef-lieu dans sa Peugeot 404
noire. Il roulait très vite, lui-même disait "sportivement";
nous avions peur, mais personne ne mouftait. Au moins cette frousse
masquait-elle celle des épreuves à venir !
Une
heure après, je pénétrai pour la première fois dans l'enceinte de l'École
Normale dont le portail était grand ouvert pour l'occasion. Après
avoir contourné des bosquets d'arbres ornementaux, je découvris un bâtiment
gris de style wilhelmien, massif et sévère. Je suivis le flux des
candidats. Des flèches placardées sur les murs nous guidèrent
jusqu'au deuxième étage, dans une salle qui m'apparut immense. Les
tables étaient étiquetées au nom des candidats classés par ordre
alphabétique. Nous étions plus d'une centaine. Au moment où je
m'assis à ma place, je remarquai avec surprise un orgue de belle taille
qui occupait tout l'avant de la salle. Cet instrument monumental me
rappelait que jadis les instituteurs étaient aussi les organistes de
leur village.
La
matinée commença par la dictée. Un zéro pour cinq fautes était éliminatoire,
même si les autres notes étaient excellentes. L'extrait s'intitulait
"Jean-Christophe et le couvreur" de Romain Rolland, une langue
soutenue mais sans pièges et, raisonnablement, je n'imaginais pas
risquer la disqualification.
Après
les questions de vocabulaire et de grammaire, ce fut l'heure du redoutable commentaire de texte. Cet exercice était
bien plus délicat que la simple rédaction. Il demandait une bonne
compréhension du texte et un début de culture littéraire qu'il
fallait exposer de façon ordonnée sans tomber dans la paraphrase ou la
digression hors sujet. Je découvris le texte à commenter : quelle
surprise ! c'était un passage de "Terre des Hommes" ! Je
trouvai de bon augure cette coïncidence qui me permettait de situer
l'extrait dans son contexte et de mieux connaître l'auteur.
L'après-midi,
nous reprîmes avec l'allemand, version et thème. Quelques candidats
avaient opté pour l'anglais, choix qui m'apparut exotique. Je n'avais
jusqu'alors jamais côtoyé quelqu'un qui ait la moindre notion de cette
langue. En sortant, j'étais rassuré pour la version, mais dans
l'incertitude pour le thème où j'étais à la merci d'erreurs de déclinaison
et de pluriel.
Monsieur
Elsener nous avait retenu le repas du soir et le coucher chez des moines
de sa connaissance. Nous disposions chacun d'une cellule, moins ascétique
cependant que les chambres chez nos parents. Après dîner, sur
l'insistance de mes camarades, je les suivis dans un tour en ville mais,
au soir de cette journée éprouvante, je trouvais que c'était un
stress supplémentaire et j'avais hâte de regagner ma chambrette pour
me concentrer sur le lendemain.
Après
un sommeil agité, entrecoupé de nombreux éveils, j'étais fin prêt
bien avant l'heure du petit-déjeuner. J'avais déjà la tête à l'épreuve
de mathématiques qui parachevait l'écrit du concours ; au programme, des exercices d'algèbre et un problème
de géométrie où je fus soulagé de ne pas "sécher".
Dans
le train, puis dans le car qui nous ramenaient dans nos villages, nous
épiloguions sans fin sur le concours, nos réponses pertinentes, nos
erreurs redoutées, nos oublis incompréhensibles, nos méprises
navrantes. En faisant le bilan de mon écrit, j'avais le sentiment de
m'en être bien tiré, mais encore fallait-il avoir réussi mieux que
les autres !
|
|
Le
BEPC. |
|
Quinze
jours après avait lieu le BEPC au lycée d'une ville voisine où je
pouvais me rendre sans difficultés en car ou en train. J'attendais cet
examen avec moins d'inquiétude car il était réputé plus facile que
le concours de l'École Normale, et là, il suffisait d'avoir la moyenne
pour être reçu. La veille des épreuves, grande nouvelle : j'étais
admis à l'écrit du concours de l'École Normale ainsi que deux de mes
camarades garçons. Cette réussite me remplit d'assurance ; je passai
le brevet avec d'autant plus de confiance que l'écrit du concours
donnait l'équivalence du BEPC. Ma petite cousine et moi sortîmes en même
temps de la dernière épreuve de l'examen. "On pourrait rentrer
ensemble en train au lieu d'attendre le bus." me dit-elle. J'étais
heureux de son invitation qui brisait enfin la barrière invisible entre
les sexes. Issus du même village, nous avions été ensemble pendant
les trois premières années de l'école primaire, puis nous nous étions
retrouvés au Cours Complémentaire où nous formions souvent la tête
de classe. Mais le frein des mentalités avait bridé nos rapports et
empêché les échanges auxquels nous aurions aspiré. A présent nous
avions atteint un nouveau palier, nous pouvions laisser derrière nous
les inhibitions de l'enfance. Je garderais longtemps en mémoire le
retour en tortillard vers notre village où nous communiâmes dans
l'euphorie de nous sentir à la fois libérés des tensions de l'examen
et du blocage des convenances.
|
|
Le
concours d'entrée à l'École Normale : l'oral. |
|
Tout
se jouerait maintenant lors de l'oral du concours d'entrée à l'École
Normale. Il se déroulait sur deux jours. Je planchai à nouveau en français et en maths, seul
devant le tableau noir et face à des examinateurs aux mimiques énigmatiques. D'autres
épreuves étaient écrites. Parmi elles, l'épreuve de
synthèse qui demandait concentration et concision.
Un professeur d'Histoire-Géographie fit un topo sur les échanges
commerciaux dans le bassin méditerranéen que nous écoutâmes sans prendre de notes. A l'issue de
son exposé, il fallait rédiger en dix lignes un résumé des idées
énoncées. Nous eûmes aussi à développer par écrit un sujet
religieux puisque nous étions sous le régime du Concordat et que nous
postulions à une place dans une école étiquetée catholique.
Enfin,
nous fûmes évalués en musique, dessin et sport. Je craignais la
musique où je présentais une liste de cinq morceaux que je devais
savoir solfier. Comme ce n'était pas mon fort, j'avais appris
par cœur chaque mélodie avec le nom des notes. J'eus de la chance : l'interrogateur choisit la Marseillaise dont je savais bien la mélodie, le
rythme et les notes : "Ré ré ré sol sol la la ré si sol, sol si
sol mi do la fa sol…" Mon jour de gloire serait-il aussi arrivé
?
|
|

|
|
En dessin, nous avions à représenter le
fronton d'un portail. J'étais soulagé de pouvoir donner libre cours à
mon imagination plutôt que de devoir reproduire un bouquet dans son
vase ! Comme
je me targuais d'être imbattable au grimper à la corde et en saut en
hauteur, je comptais sur le sport pour grappiller quelques points sur
mes rivaux. Pour la première fois, je foulais une installation que je
n'avais vue qu'en photo : un stade ceint d'une piste
d'athlétisme et doté d'aires pour les lancers et les sauts. Dès le début
des épreuves, je dus constater que je n'étais pas le seul sportif
fervent. Il y avait même un candidat filiforme aux longues jambes qui
avait choisi de courir le 1000 mètres. Tout seul sur la piste, il déroulait
ses foulées au rythme d'une respiration puissante. Candidats et
examinateurs le suivirent du regard pendant ses deux tours et demi et,
après son arrivée, des commentaires flatteurs évoquèrent Michel
Bernard et Michel Jazy qui s'étaient illustrés l'année précédente
aux JO de Rome.
|

Michel
Jazy et Michel Bernard : deux formidables athlètes qui ont enthousiasmé la
jeunesse des années 1960. |
|
Pendant
ces deux jours, les candidats pouvaient manger et loger à l'école.
Ainsi je fis connaissance avec le grand dortoir que des cloisons de bois
subdivisaient en
chambrées sans porte de quatre lits. Il
régnait une atmosphère étrangement feutrée parmi cette trentaine
d'adolescents. Seuls quelques élèves issus d'un même établissement
s'étaient regroupés et donnaient parfois de la voix. Les autres
s'observaient sans vraiment rompre la glace. Ces pensionnaires d'une
nuit étaient mes rivaux
aujourd'hui ; pourtant vingt-cinq d'entre nous seraient demain
et pour quatre années des compagnons d'études et, qui sait ? des amis pour la vie.
Mais serais-je du nombre ?
Après
le repas du soir, nous voyant désœuvrés et désorientés, un
surveillant à la coiffure léchée et aux lèvres minces nous proposa de suivre les informations
à la télévision. Le récepteur était installé dans la salle de
musique où en temps ordinaire mon regard aurait été accaparé par
un petit orgue et un piano à queue. Mais là, c'était l'écran
cathodique qui m'hypnotisait. Je n'étais pas le seul ! Tous mes
camarades fixaient avec fascination cet appareil magique qui n'avait pas
encore fait son entrée dans nos familles. Pendant
une demi-heure, le spectacle du monde subjugua nos yeux et notre esprit.
Au moment de regagner le dortoir, je réalisai que pendant une
demi-heure, j'avais complètement oublié les enjeux du concours et
même l'endroit où j'étais. Du coup, l'École Normale et son internat
prenaient un nouvel attrait jusque-là insoupçonné !
|
|
Le
concours d'entrée à l'École Normale : admis ! |
|
Les
épreuves de l'oral terminées, nous attendîmes
sur place l'annonce des résultats. Pour tromper le tourment de
l'incertitude, nous faisions des tours et des détours dans les allées
du parc où se dressait un séquoia majestueux. Intérieurement, je
tremblais d'émotion et mon âme balançait entre l'espérance et le découragement.
Ce bâtiment, ce jardin, cette cour seraient-ils ma maison pour quatre
ans et à jamais dans ma mémoire ? Ou bien, dans quelques minutes, les
quitterais-je pour ne plus y revenir ?
Soudain
une rumeur s'éleva et les candidats dispersés convergèrent vers
l'escalier central. Un aréopage de professeurs était sorti sur le
perron et entourait le directeur de l'établissement qui n'eut pas de
mal à obtenir le silence. Il proclama les résultats, dans l'ordre d'un
classement qui allait poursuivre l'élève-maître tout au long de sa
scolarité, un rang qui ferait à jamais partie de sa personne.
"Premier, et major de la promotion 1961-1965 : ………" Puis
d'autres noms suivirent. Le souffle court, chacun était à l'affût du
sien. Ma délivrance arriva avant que j'aie eu le temps de trop m'alarmer :
à la huitième place, j'entendis mes nom et prénom !
Mes
deux camarades du CEG étaient également reçus. En même temps que la
joie nous submergeait, nous étions désemparés. Ce résultat tant espéré,
maintenant qu'il était là, comment allions-nous l'apprivoiser ? Il
nous faudrait des jours et des semaines pour prendre la mesure de l'événement
qui venait d'infléchir
notre destin. En attendant, nous jouâmes des coudes pour aller
contempler la liste dactylographiée des admis et nous repaître du
plaisir suprême d'y voir figurer notre nom et notre rang.
Vers
20 Heures, quand l'autocar qui nous ramenait dans nos villages fit halte
dans le bourg du CEG, nous vîmes que Monsieur Elsener attendait sur la
place. Il nous repéra dans le bus et s'approcha. Nous fîmes glisser la
vitre pour pouvoir lui parler.
-
Alors ? interrogea-t-il d'un air faussement détaché.
-
Admis, tous les trois !
-
Je l'avais toujours dit ! fut son commentaire en s'écartant du véhicule
qui allait repartir. Il nous suivit des yeux et malgré sa mine bourrue,
je lus dans son regard la fierté du devoir accompli.
|