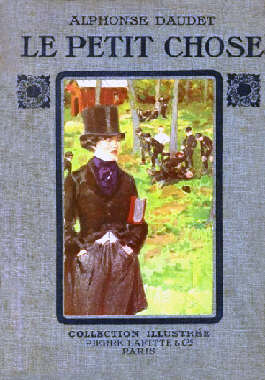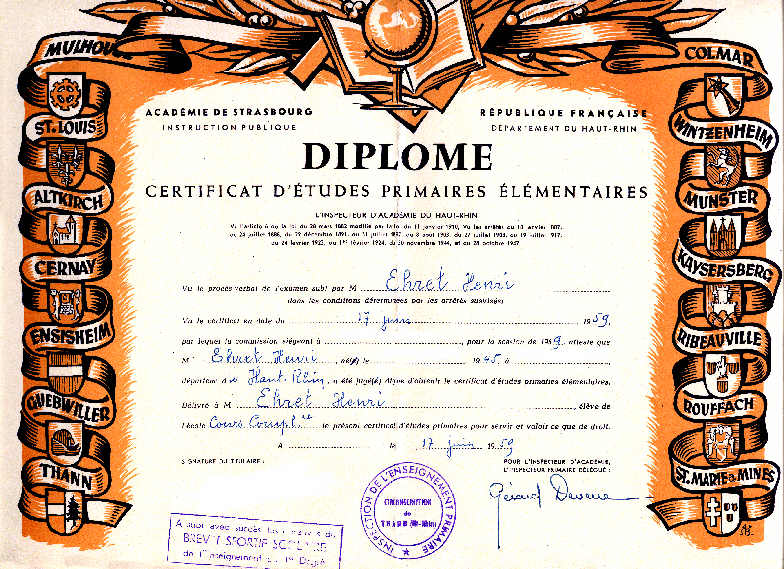|
En
français également, un nouveau professeur nous attendait. La douce
Mademoiselle Muller avait été remplacée par une titulaire,
Mademoiselle Fournier, dont c'était la deuxième année d'enseignement.
Sortie en tête de l'École Normale, elle avait poursuivi ses études
en Lettres Supérieures dans un lycée parisien. Francophone de
naissance, dotée d'un tempérament inflexible, débordante d'ambition
pour notre réussite, cette jeune fille de vingt-deux ans allait
imprimer sa marque dans ma pensée, mon expression et ma sensibilité.
Les
prémices furent rudes. Mademoiselle Fournier eut tôt fait de nous
signifier que l'atmosphère de placide décontraction du cours de français
de l'année précédente n'était plus de mise. Elle exigeait un silence
absolu et une attention sans faille. Le moindre écart attirait sur son
auteur une réprimande qui jetait l'effroi sur toute la classe. Les leçons
devaient être sues sur le bout des doigts et le malheureux qui s'empêtrait
dans l'énoncé d'une définition de grammaire pouvait s'attendre à la
copier tant de fois qu'il la saurait par cœur jusqu'à la fin de ses
jours.
J'avais terminé la classe de 6e dans une phase euphorique,
heureux de pouvoir participer et d'exprimer mon imagination en
rédaction. En ce début de 5e, je réussis correctement les premiers travaux écrits,
mais à l'oral j'étais paralysé par la sévérité du professeur. Si
je levais le doigt pour participer, une réponse fausse pouvait déclencher
ses foudres. Mais si je m'en abstenais, j'étais à la merci d'une
interrogation directe de sa part encore plus redoutable. Pendant
plusieurs semaines, je crus que je ne sortirais pas des affres de cette
double contrainte.
Pourtant,
insensiblement, je sentis que le feeling s'établissait avec
Mademoiselle Fournier. Je devais reconnaître que la rigueur de ses leçons
convenait à mon esprit et je devinais qu'elle appréciait mes efforts
à l'écrit. Je commençais même à me manifester à l'oral car à présent
je discernais de la sensibilité derrière sa façade d'intransigeance.
Certes, ce professeur si jeune nous imposait une autorité implacable,
mais je ne doutais pas qu'au fond elle nous aimait. Jusque là, dans la
famille ou à l'église, je n'avais pas été épargné par la violence
de mes éducateurs. Ceux-là avaient le dessein de me briser. Ils
maltraitaient tant mon être que je m'étais persuadé qu'ils haïssaient
mon désir de liberté et d'épanouissement. Au contraire, dans la
fermeté de Mademoiselle Fournier transparaissait son attachement à ma
réussite. Elle était dure vis à vis de mes erreurs, de mon ignorance,
de mes lacunes, de mes manquements, mais elle estimait ma personne et se
réjouissait de ses progrès. Bientôt je reconnus que dans son gant de
fer se cachait en réalité une main de velours.
C'est
sous le puissant ascendant de Mademoiselle Fournier qu'au courant de la
5e je parvins à penser exclusivement en français.
|