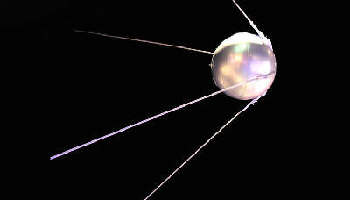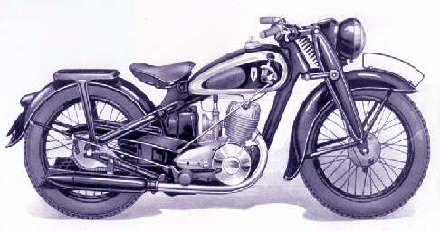| Monsieur
Heldgraf. |
|
Dès
les premières heures de la rentrée, les anciens nous avaient tressé
les louanges d'un professeur qui semblait être leur idole à tous,
Monsieur Heldgraf. C'était notre professeur d'Histoire-Géographie,
mais le hasard de l'emploi du temps nous obligea à patienter trois
jours avant de faire sa connaissance. Dès son entrée dans la classe,
sa personnalité nous en imposa. Il ne cherchait pas la proximité comme
d'autres enseignants. C'était le seul à nous vouvoyer, ce qui ne nous
était jamais arrivé. Tandis qu'il appelait les filles par leur prénom,
il s'adressait aux garçons en usant de leur nom de famille ce qui nous
glaça quelque peu. Aucun doute, Monsieur Heldgraf ne serait ni notre
copain, ni notre grand frère, ni notre père, mais il fut notre maître
!
Rapidement,
il nous subjugua par son enseignement, ses talents multiples et son
charisme hors du commun. Dès ses premières leçons, l'histoire me
captiva et je sus que ce serait pour la vie. Cependant, plus encore que
par la résurrection des civilisations passées, c'était par son
ouverture sur le monde présent que Monsieur Heldgraf nous séduisait.
Il
nous en offrit un premier aperçu dès la seconde séance, le matin du
samedi 5 octobre 1957. Au lieu de poursuivre le thème d'Histoire
commencé la veille, il nous annonça d'emblée en entrant dans la
classe : " Hier soir a eu lieu un événement capital pour votre
avenir !" Personne ne savait de quoi il s'agissait ; nous restâmes
figés dans l'incertitude de cette nouvelle singulière, catastrophique
ou heureuse ? Après quelques secondes de suspens, Monsieur Heldgraf
nous révéla que la veille, l'URSS avait lancé Spoutnik, le premier
satellite artificiel de la terre, une sphère de 58 cm de diamètre qui
faisait le tour de la planète en 96 minutes en émettant un signal
sonore : bip, bip, bip... Comme la classe semblait dubitative quant à
l'importance de l'événement, le professeur expliqua qu'à présent
nous étions entrés dans l'ère de la conquête de l'espace. La
science-fiction devenait réalité, les albums de Tintin une prémonition
avérée. Avec enthousiasme, Monsieur Heldgraf exposa les retombées que
Spoutnik laissait présager. Il démontra, schémas sur le tableau à
l'appui, comment des transmissions radio et télévision via des
satellites relais pourraient couvrir le monde entier en quelques
secondes. Et bientôt nous disposerions de photographies de la terre vue
de l'espace et, rêve de tout géographe d'alors, contempler sa rotondité
qu'aucun humain n'avait encore vérifiée de visu !
|
|
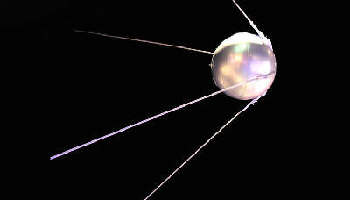
|
|
Spoutnik
I, premier satellite artificiel de la terre.
|
|
Tout
au long de mes quatre années dans l'établissement, Monsieur Heldgraf
m'initia au monde dont je prenais peu à peu conscience. Dans cette période
de conflits permanents, il avait le don de saisir les événements
dramatiques au chaud de l'actualité. Car les périls intérieurs et extérieurs
nous angoissaient et ils étaient nombreux dans ces années troublées :
la guerre froide et la menace nucléaire, la guerre d'Algérie où étaient
mobilisés nos frères et nos voisins, la guerre civile larvée entre
Français, les attentats terroristes du FLN et de l'OAS. Monsieur
Heldgraf nous persuada que c'était en regardant les événements en
face et en les comprenant que nous pourrions y faire front en futurs
adultes.
Lui-même
n'était pas avare de récits tirés de sa propre vie et dont nous
raffolions. Les plus palpitants se rapportaient aux péripéties vécues
pendant la Seconde guerre mondiale. Adolescent en 1940, il avait assisté
aux combats de retardement de l'armée française face à l'attaque
allemande. Puis, il avait passé l'Occupation dans le Sud-Ouest de la
France, à Périgueux, où son École Normale était repliée. Après
deux années d'accalmie, l'invasion de la zone libre en novembre 1942
mit les jeunes Alsaciens sous la menace d'une arrestation qui pouvait
aboutir à leur incorporation de force dans la Wehrmacht. Pour les protéger,
l'administration de l'École attribua à chacun une fausse identité et
cacha leurs véritables papiers dans un endroit sûr jusqu'à la Libération.
Depuis
le lendemain de la guerre, Monsieur Heldgraf enseignait au Cours Complémentaire
dont il était le professeur le plus innovant. A présent au début de
la trentaine, les cheveux en arrière souvent en bataille, des lunettes
à grosse monture noire sur le nez, cet intellectuel ne répugnait
cependant à aucun exercice sportif et s'auréolait d'une réputation
d'aventurier. Des générations de jeunes adolescents furent conquis par
cette rare conjonction des aptitudes du corps et des dons de
l'intelligence.
A
cette époque où ses collègues étaient piétons, Monsieur Heldgraf
arrivait à l'école avec sa grosse moto
DKW* qu'il garait sous le préau. Nous admirions sa machine, dont
Monsieur Heldgraf aimait nous vanter les mérites. Cette moto,
disait-il, avait été le seul engin de l'armée allemande en Russie à
ne pas être bloqué par la raspoutitsa, si bien que les soldats
l'avaient surnommée "Das kleine Wunder"**. Ajoutant les actes aux
paroles, lors de la vague de froid de février 1956 où la région
connut des températures sibériennes, Monsieur Heldgraf traversa sur la
glace le plus grand lac des environs au guidon de sa "petite
merveille".
|
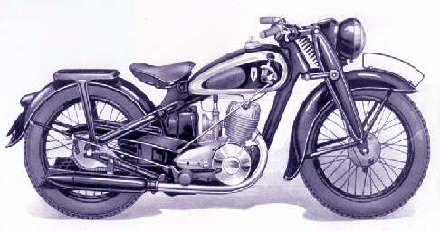
Moto DKW de la fin des années 1930.
* DKW :
Dampf-Kraft-Wagen.
** "Das kleine
Wunder" : "La petite merveille".
|
|
Monsieur
Heldgraf entraînait ses élèves dans ses multiples passions dont la
photographie n'était pas la moindre. En 1940, âgé d'une quinzaine
d'années, il avait déjà bravé les dangers pour photographier des
ponts effondrés, des chars détruits et même un défilé de troupes
ennemies. A présent, il mitraillait personnages et événements,
paysages et scènes de vie, avec une prédilection pour l'insolite et le
pittoresque. A l'école, il créa un photo-club et installa un
laboratoire rudimentaire sous un escalier de la cave où nous apprîmes
à développer et à tirer les clichés pris avec les modestes appareils
de nos parents. Notre mentor nous engagea à photographier autour de
nous les travaux et les gestes ancestraux car, disait-il, ils allaient
bientôt disparaître. Malgré notre incrédulité, nous suivîmes ce
conseil qui permit de garder la mémoire de bien des images d'une époque
révolue.
La
géologie était une autre corde de son arc. Il l'enseignait en 4e
en s'appuyant sur les ressources locales dont il était un spécialiste
reconnu. Aucun élève n'a oublié les sorties géologiques, tantôt sur
les sols primaires cristallins, tantôt sur les terrains secondaires car
nous étions situés tout près d'une importante faille entre Vosges et
plaine d'Alsace. Ces sorties à vélo d'une demi-journée rayonnaient
sur une quinzaine de kilomètres autour de l'école. Que de peine pour
rejoindre des sites invisibles aux yeux du profane, mais quel bonheur
d'apprendre à y reconnaître les grauwackes, les grès, les mollasses,
les calcaires… Et quelle émotion quand dans nos mains des fossiles
d'origine marine nous révélaient que notre petit coin d'Alsace avait
connu un climat chaud sous une latitude proche de l'équateur. Par la
magie des explications du professeur, c'est à l'échelle de millions
d'années que les moraines, les strates, les affleurements nous
racontaient l'histoire de notre terre natale que désormais nous ne
verrions plus du même œil. Un jeudi, quelques garçons volontaires
suivirent leur professeur dans la plus importante grotte d'Alsace que
Monsieur Heldgraf avait explorée une dizaine d'années auparavant. Ni
les ténèbres, ni la boue, ni la rivière souterraine ne découragèrent
les spéléologues en herbe !
|

Élèves
en route vers un cours de géographie et de géologie en situation.
|
|
Monsieur
Heldgraf avait à cœur d'associer l'intérêt pour le vaste monde à la
connaissance de notre cadre de vie. Il avait ranimé l'histoire locale,
sauvé les archives de l'abandon et sorti de l'oubli les personnages
illustres de la cité. Il adaptait ses découvertes au plan scolaire en
nous faisant travailler sur les vestiges médiévaux de notre ville, ses
remparts, son abbaye, ses haut-fourneaux, ses manufactures. Étudier ces
données qui ne figuraient alors dans aucun livre me fit éprouver
l'exaltant sentiment de ceux qui sont les premiers à acquérir un
savoir jusqu'ici caché au grand nombre.
Dans
l'esprit de Monsieur Heldgraf toutes les disciplines et toutes les
techniques participaient à la connaissance de notre environnement.
Pendant plusieurs années, c'est par voie aérienne que ses élèves découvraient
la géographie régionale. A bord d'un bimoteur, ils survolaient les
sommets vosgiens, leurs villages natals ainsi que la plaine rhénane et
les principales villes. Pour ces jeunes passagers dont c'était en même
temps le baptême de l'air, quelle leçon inoubliable ! Le professeur
nous engageait à sortir des sentiers battus et à fureter dans les
coins et recoins de notre vallée. Être curieux de tout devint notre
adage. C'était à qui apporterait en classe une roche singulière, un
champignon inconnu, un document intriguant. Monsieur Heldgraf les
examinait pour en dévoiler les mystères. Précurseur dans le domaine
audio-visuel, il introduisit les diapositives comme support de ses leçons
et aménagea au grenier de l'école une salle de projection pour des
films de cinéma. Et, en hiver, pour que ses élèves dépassent le
stade de la luge sur les pauvres pentes de leur village, il organisa des
sorties de ski vers les pistes du Ballon d'Alsace.
Pour
moi, Monsieur Heldgraf a incarné une autre image de l'adulte que celle
que j'avais héritée de mes parents. Il alliait le savoir et
l'ouverture d'esprit avec le dépassement des normes de la vie
villageoise conformiste, timorée et utilitariste. Avec ce professeur,
ma réaction n'était jamais : " A quoi cela sert-il ? " mais
"Comme c'est passionnant !" Il savait séduire mon esprit et,
en même temps, par la distance qu'il conservait entre sa personne et l'élève,
il respectait ma conscience et ma liberté. Je rêvais de devenir le
disciple d'un tel maître
|