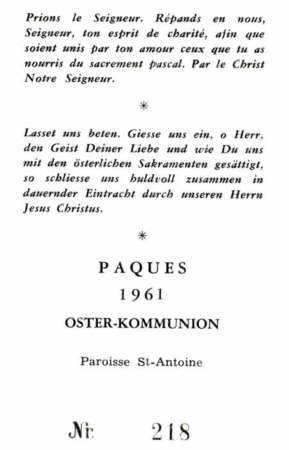|
La
Semaine Sainte.
|
|
Le
dimanche
des Rameaux.
Du
dimanche des Rameaux jusqu’à Pâques, la Semaine Sainte était le
sommet de l’année liturgique. Plus que jamais, les offices se
multipliaient et me sollicitaient pendant de nombreuses heures. Ils
comportaient des rites énigmatiques uniques dans l’année dont je n’ai
découvert le sens que bien plus tard. A l’époque,
personne ne me les expliquait. Pourtant j'étais interpellé par ces pratiques séculaires
qui touchaient
aux symboles fondamentaux de l’existence humaine : le feu,
l’eau, la nuit, la lumière, le mystère, la peur, la fertilité.
Le
dimanche des Rameaux ouvrait la semaine sainte ; les garçons
venaient à la messe en portant fièrement ce que nous appelions les
palmes. C’était un bâton plus haut qu’eux, joliment écorcé, au
sommet duquel était fixé un bouquet de buis et de houx décoré de
fleurs et de rubans. Se postant de part et d’autre de l’allée
centrale de l’église, ils formaient une haie d’honneur pour le curé
qui venait les bénir. Puis, tous les fidèles, les porteurs de palmes
en tête, partaient en procession dans le village.
|

Procession
du dimanche des rameaux de nos jours. Les bouquets portés au
bout d'une perche par les servantes d'autel rappellent les palmes en usage en Alsace dans les années 1950.
|
|
Au retour, une scène
curieuse se déroulait sur le parvis. L’assistance était massée
devant les portes fermées de l’église où seule la chorale avait pénétré.
Le prêtre, flanqué des servants de messe dont l’un tenait la croix
de procession à l’horizontale, le pied en avant, s’approchait de
l’huis fermé et chantait :
"Attolite portas…" ("Ouvrez les portes..."
) Puis,
accompagnant le geste de
l’enfant de chœur, il donnait un coup avec la hampe de la
croix dans le vantail.
A
ce moment s’installait un dialogue chanté en latin entre la chorale
à l’intérieur de l’église et le prêtre qui en sollicitait
l’accès. Par trois fois, le célébrant demandait l’ouverture des
portes, psalmodiant à chaque reprise sur un ton plus haut et frappant
plus fort de la croix sur le battant. De l’intérieur de l’église
parvenaient un peu assourdies les réponses des chantres
qui ouvraient finalement les portes après la troisième injonction du célébrant.
Les choristes représentaient les anges attendant l'arrivée de Jésus
dans la Jérusalem céleste tandis que les coups assénés témoignaient
que c’était la croix qui ouvrait la porte du ciel. Lorsque enfin les
battants s’écartaient, le curé, les porteurs des palmes et
tous les fidèles pénétraient dans l’église au son de "Israël
es tu rex…"
Après
la messe, les garçons emportaient les palmes vers leur domicile et
allaient les planter par la perche dans le potager. Ils y resteraient
jusqu’à Pâques pour appeler la fertilité sur la terre nourricière.
Ensuite, le bouquet était accroché dans l’étable dont il devait écarter
incendies, épizooties et autres fléaux que les paysans craignaient
depuis la nuit des temps.
|
|
Le
Jeudi Saint.
Le
Jeudi Saint, était appelé en dialecte "Grianadonstig" * sans que quiconque ait su
pourquoi. Ce jour-là avaient lieu des rites inhabituels et l’église
changeait de visage. Lors de la messe, après le Gloria, les cloches
s’arrêtaient de sonner et les longues lanières de cuir avec
lesquelles on les manœuvrait disparaissaient dans les combles du
clocher. L’orgue également se taisait et, pour rythmer les offices,
le servant de messe échangeait sa sonnette d’autel contre un
martelet. C’était une planchette munie d’un manche sur laquelle un
maillet venait frapper alternativement en avant et en arrière grâce à
un mouvement sec du poignet. 
Martelet
qui remplaçait la sonnette d'autel du Jeudi Saint jusqu'au Samedi Saint.
|
|
Après la messe, le Saint Sacrement était
transféré avec solennité sur un autel latéral. Ce reposoir restait
alors le seul endroit de l’église décoré de fleurs et éclairé de
cierges. Le chœur en revanche prenait un aspect lugubre : croix
voilée de violet, tabernacle vidé, cierges éteints, autel dégarni du
missel, des canons, des nappes et de tous autres parements. Ce dépouillement
de l’autel, symbole du Christ, devait rappeler la prophétie de
David : "Ils se sont partagé mes vêtements…"
|
|
Le
Jeudi et le Vendredi Saints étaient jours d'adoration continue. Les fidèles
se succédaient d’heure en heure selon une organisation affichée par
le curé qui convoquait ses ouailles par groupes selon l’âge, le sexe
et le quartier : femmes de tel quartier, hommes de tel autre, garçons
ou filles d’âge scolaire, jeunes gens, jeunes filles… Pour les
servants de messe, cette adoration était une corvée. A tout moment,
deux d’entre nous devions être présents devant le reposoir. A
genoux, le regard fixé vers l’avant, nous endurions une heure
d’immobilité. Devant nous, l’autel faiblement éclairé par deux
cierges, derrière nous, les prières en allemand débitées selon
l’heure par les voix aigres des femmes ou par le roulement rocailleux
des hommes. Je souffrais particulièrement de ne pas pouvoir mesurer
l’écoulement du temps. Aucun enfant n’avait de montre et
l’horloge de l’église ne sonnait pas. Parfois j’essayais
d’estimer le temps écoulé selon le nombre de dizaines de chapelets déjà
expédiées, mais bientôt je m’embrouillais dans mes comptes et n’étais
pas plus avancé ! D’autres fois, je contemplais les stalactites
de cire fondue qui glissaient le long des cierges. Je fixais mentalement
un repère sur le cierge et attendais que la coulée blanche
l’atteigne. Plus précis et plus prometteurs étaient les bruits qui
filtraient du dehors. Quelques éclats de voix enfantines ? C’étaient
peut-être les prochains servants de messe qui, arrivés en avance,
couraient autour de l’église. Quel bonheur quand nous entendions la
porte de l’église s’ouvrir, puis le pas de nos remplaçants
s’avancer dans l’allée. Lorsqu’ils arrivaient à notre hauteur,
selon la règle de ces jours particuliers, ils faisaient une génuflexion
à deux genoux et baissaient la tête en direction du reposoir. Il n’était
pas rare qu’à cette saison tombent des giboulées de neige mouillée
qui tenait sur la chevelure de nos camarades jusqu’à ce que
l’inclination la fasse tomber sur le dallage. Nous nous amusions
furtivement de cette scène observée du coin de l’œil, rassérénés
à présent par la certitude que notre séance touchait à sa fin.
|
 |
Le
soir du Jeudi Saint, l’office des ténèbres réussissait à angoisser
les moins impressionnables. Les fidèles remplissaient, silencieux, la
nef obscure de l’église tandis que dans le chœur brûlaient sur un
chandelier triangulaire quinze cierges représentant le Christ, les onze
apôtres fidèles et les trois Marie *. Dans
cette atmosphère sépulcrale, les choristes chantaient les dramatiques
lamentations du prophète Jérémie. Après chaque psaume, un cierge était
éteint pour symboliser l’abandon de Jésus par ses apôtres. Après
le quatorzième psaume, seul le cierge au sommet, figurant le christ,
restait allumé.
|
|
Pendant l'office des ténèbres. |
|
Toute l’assistance récitait le Pater Noster à voix basse, puis le chœur psalmodiait le
"Miserere." Un ultime
degré de la dramaturgie était atteint lorsque pour évoquer les ténèbres
de la crucifixion, le prêtre allait cacher le cierge allumé derrière
l’autel, plongeant le sanctuaire dans la nuit totale. A ce moment,
pour simuler le tremblement de terre dont parle l’évangile, le plus
grand vacarme devait assourdir l’église. Les servants de messe en
donnaient le signal grâce à une imposante crécelle dont toute une série
de marteaux de bois commandés par une manivelle frappaient la caisse de
résonance en rafales continues. Aussitôt, les jeunes garçons dans les
bancs se joignaient au tapage en actionnant de toutes leurs forces crécelles,
martelets et claquoirs qu’ils avaient apportés à cette intention,
trop heureux de pouvoir faire impunément du bruit dans l’église.
Enfin, le cierge caché réapparaissait, ramenant une lueur dans le chœur
et mettant aussitôt fin au tintamarre. Malgré le caractère ludique du
tohu-bohu si insolite dans une église, cet office m’installait dans
un malaise qui ne ferait que s’aggraver le lendemain.
Exemples
de grosses crécelles à manivelle.
|


 Cependant
le clou du trajet était le moment où nous croisions la
procession venue de la paroisse voisine. En guise de salut, les
servants en tête du cortège inclinaient leur croix de façon
à ce que les deux crucifix s’embrassent. Ce geste symbolique
se transformait vite en joute. En quelques fractions de seconde
et sans gesticulation qui aurait pu attirer l’attention des
curés, chacun des deux porteurs appuyait subrepticement sur la
croix adverse dans l’espoir de la faire fléchir. Le vainqueur
de ce bras de fer recueillait l’estime de son camp ; le
vaincu se promettait une revanche au retour de la procession où
la même scène allait se rejouer. Pendant la durée du
croisement, l’examen des villageois visiteurs qui eux-mêmes
nous dévisageaient d’un œil oblique, nous distrayait, tandis
que l’interférence des chants et des prières des deux
processions créait une cacophonie saugrenue.
Cependant
le clou du trajet était le moment où nous croisions la
procession venue de la paroisse voisine. En guise de salut, les
servants en tête du cortège inclinaient leur croix de façon
à ce que les deux crucifix s’embrassent. Ce geste symbolique
se transformait vite en joute. En quelques fractions de seconde
et sans gesticulation qui aurait pu attirer l’attention des
curés, chacun des deux porteurs appuyait subrepticement sur la
croix adverse dans l’espoir de la faire fléchir. Le vainqueur
de ce bras de fer recueillait l’estime de son camp ; le
vaincu se promettait une revanche au retour de la procession où
la même scène allait se rejouer. Pendant la durée du
croisement, l’examen des villageois visiteurs qui eux-mêmes
nous dévisageaient d’un œil oblique, nous distrayait, tandis
que l’interférence des chants et des prières des deux
processions créait une cacophonie saugrenue. 




 Cette
journée d’automne, alors que les arbres étaient déjà dépouillés,
la bise mordante et le soleil pâle et froid, me plongeait dans une
atmosphère crépusculaire. On avait beau nous répéter que la Toussaint,
(Àllerheiliga, Allerheiligen)*, était une fête joyeuse, elle était assombrie par l’ombre de la mort.
Depuis la première messe commencée avant l’aube jusqu’à la nuit
tombée, le 1er
Cette
journée d’automne, alors que les arbres étaient déjà dépouillés,
la bise mordante et le soleil pâle et froid, me plongeait dans une
atmosphère crépusculaire. On avait beau nous répéter que la Toussaint,
(Àllerheiliga, Allerheiligen)*, était une fête joyeuse, elle était assombrie par l’ombre de la mort.
Depuis la première messe commencée avant l’aube jusqu’à la nuit
tombée, le 1er

 A
ce moment seulement, la magie de Noël me gagnait. La représentation naïve
de la nativité, les lumières de couleurs, l’expression sereine des
personnages autour de la mangeoire me touchaient le cœur, tout comme la
rare complicité avec mon père. Déjà quinquagénaire, et d’habitude
peu accessible aux joies enfantines, il partageait avec moi ce moment
d’émotion. Loin de l’apparat creux des rites qui étouffait
l’esprit de Noël, je ressentais que ce jour était porteur de paix,
d’amour, de gratitude. Pour un instant bien court, j’étais en
harmonie avec ceux qui baignaient dans la féerie de Noël. J’en éprouvais
une bouffée de joie vite mêlée d'amertume, car en moi-même, je désespérais d’échapper un jour à l’écrasante machine de l’Église qui me
priverait chaque année de vivre des Noëls heureux.
A
ce moment seulement, la magie de Noël me gagnait. La représentation naïve
de la nativité, les lumières de couleurs, l’expression sereine des
personnages autour de la mangeoire me touchaient le cœur, tout comme la
rare complicité avec mon père. Déjà quinquagénaire, et d’habitude
peu accessible aux joies enfantines, il partageait avec moi ce moment
d’émotion. Loin de l’apparat creux des rites qui étouffait
l’esprit de Noël, je ressentais que ce jour était porteur de paix,
d’amour, de gratitude. Pour un instant bien court, j’étais en
harmonie avec ceux qui baignaient dans la féerie de Noël. J’en éprouvais
une bouffée de joie vite mêlée d'amertume, car en moi-même, je désespérais d’échapper un jour à l’écrasante machine de l’Église qui me
priverait chaque année de vivre des Noëls heureux.




 Le
culte commençait dehors, autour de ce brasier que je trouvais
effrayant. Le feu était au cœur de la cérémonie riche en pratiques
étranges : les flammes aspergées d’eau bénite, des braises prélevées
et
Le
culte commençait dehors, autour de ce brasier que je trouvais
effrayant. Le feu était au cœur de la cérémonie riche en pratiques
étranges : les flammes aspergées d’eau bénite, des braises prélevées
et