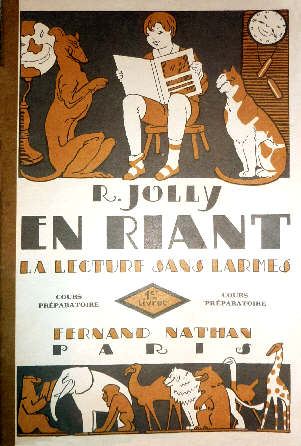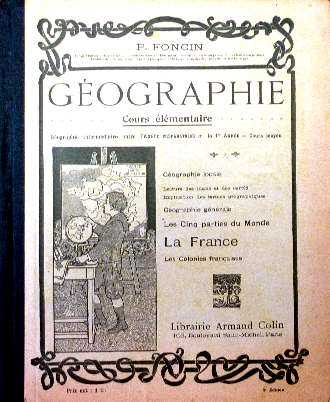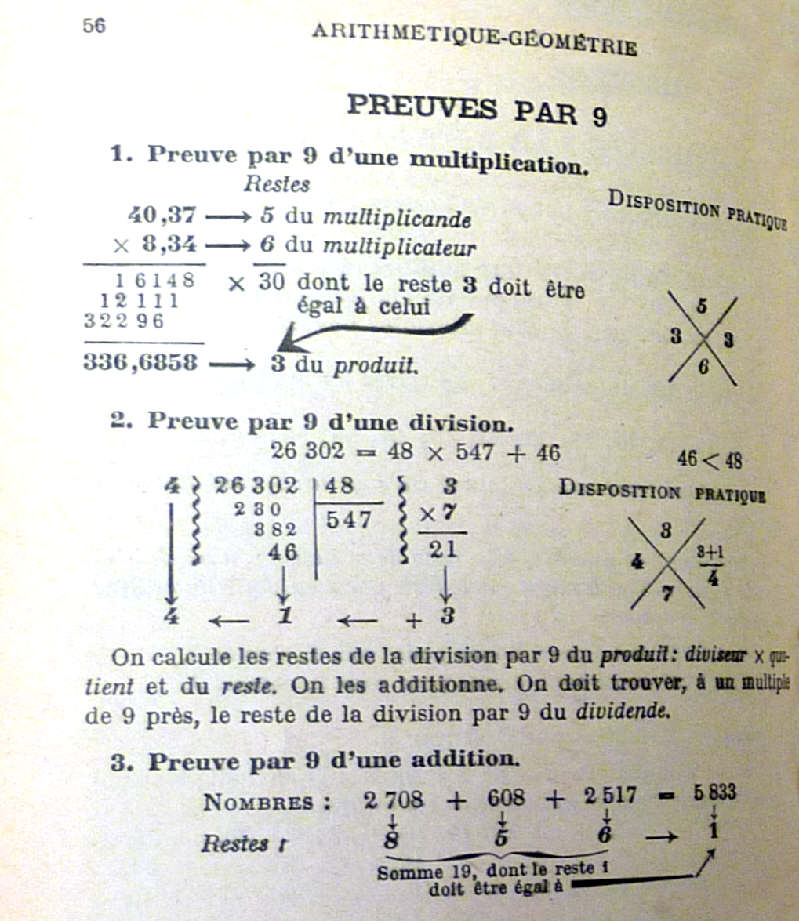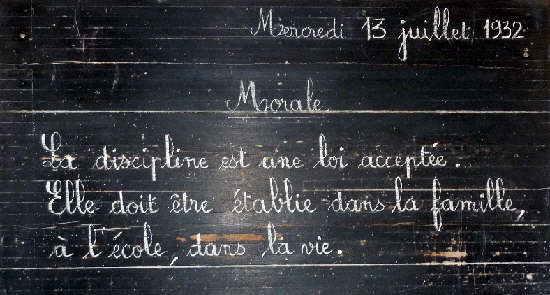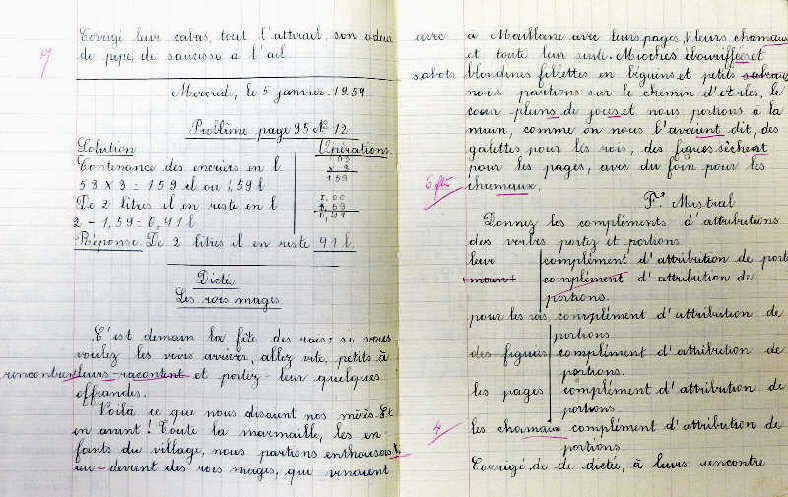|
Devant
nous s'élevait sur son estrade le bureau du maître,
encadré par deux lourds tableaux
noirs réversibles montés sur des piétements en bois massif. Des
pitons plantés dans le mur supportaient
une règle d'un mètre, une équerre et un rapporteur de couleur jaune,
ainsi qu'un imposant compas à la pointe menaçante. Par terre, une
corbeille à papier en fil de fer tressé attirait ceux qui aimaient se
dégourdir les jambes sous prétexte d'y jeter une feuille froissée ou
de vider leur taille-crayon. Dans l'angle de droite, sur une armoire partiellement masquée
par le tableau, trônait un globe
terrestre. J'aurais aimé le contempler de près et d'un
mouvement de l'index lui imprimer une rotation autour de son axe
incliné. Chaque matin, le maître venait prendre dans l'armoire la
bouteille d'encre bleu foncé munie d'un bec verseur recourbé. Quand il
venait remplir mon encrier, j'aimais voir couler le liquide sombre qui dégageait
une odeur entêtante jamais retrouvée depuis.
Mais
plus que le mobilier, c'étaient les cartes et les planches didactiques
garnissant les cloisons qui attiraient mon regard. A cette époque sans
télévision et sans magazines, je souffrais d'une telle faim d'images
que n'importe quelle photo, n'importe quelle gravure, n'importe quel
chromo excitait mon intérêt. Ces représentations aiguillonnaient
les deux besoins qui m'habitaient, l'appétit de savoir et la soif de m'évader
de mon univers étriqué.
Nombre
de cartes et d'illustrations me parlaient de la France. C'était mon
pays, mais je le connaissais si peu ! Sa langue m'était étrangère, ses
régions méconnues, ses coutumes ignorées. Autour de moi,
presque rien ne témoignait de notre appartenance à cette
nation. Les villageois ne parlaient que l'alsacien, et lorsqu'ils se
retrouvaient à l'église, c'était en allemand qu'ils priaient et
chantaient. Dans ce bain germanique, la France était confinée à l'école,
étroite oasis où elle tâchait de nous apprivoiser, nous, petits Français
depuis peu recouvrés.
Pendant
que mes yeux voyageaient d'une carte à l'autre, naissaient dans mon cœur
des sentiments contrastés.
La
carte des départements m'intimidait. La France était si grande ! les départements
si nombreux ! et notre
petit coin d'Alsace était relégué aux confins du pays. La taille des
noms des départements était proportionnelle à leur population : le
Pas-de Calais, le Nord, le Finistère, la Loire Inférieure, le Rhône,
la Loire, les Bouches du Rhône, la Gironde, la Seine Inférieure s'étalaient
sur l'hexagone et écrasaient les autres par leurs grosses lettres
noires. Le département de la Seine avait en outre le privilège d'être
inscrit en majuscules hautes et épaisses alors que je ne distinguais même
pas son minuscule territoire. La
carte de la France forestière me rassurait. Notre forêt vosgienne
rivalisait sans complexes avec les forêts du Jura, du Morvan, de
l'Argonne, des Maures et de l'Estérel et ridiculisait même maintes forêts
de Bretagne et du Massif Central. Seule l'écrasante tache verte
curieusement nommée "Pins des Landes" nous en imposait sans
discussion possible. Les
dessins des tableaux de géographie me donnaient un sentiment grisant de
dépaysement. Les paysages représentés ne ressemblaient en rien à
ceux que nous connaissions. Là, dans un vaste bassin bordé de lignes de
côtes successives coulait un fleuve majestueux, sinuant à travers ses
méandres. Ailleurs, une région littorale avec ses falaises et ses
criques, ses plages et ses dunes, son estuaire et son port. Même les
montagnes ne s'apparentaient pas aux nôtres. Actifs ou éteints, les
volcans effrayaient, et que dire des formes étranges du relief calcaire
? les dolines, les résurgences, les avens, bien que dessinés, m'étaient
inimaginables.
Le
planisphère me donnait le vertige par les dimensions incroyables des océans
et des continents. La France elle-même, qui tout à l'heure m'écrasait
par son immensité, n'était plus qu'une petite pièce du puzzle des États
du monde. Heureusement elle se prolongeait par les surfaces roses bien
plus flatteuses de l'Union Française. "AFN", "AEF",
"AOF", "Madagascar", "Indochine Française",
étaient imprimées en gras comme autant de titres de possession. Ces
territoires exotiques, tellement plus étendus que la France métropolitaine,
gonflaient ma fierté. Pour moi qui n'avais jamais dépassé les limites du
canton, ces contrées lointaines enflammaient mon imagination. Leurs
peuples bigarrés liés à la France m'émouvaient comme me bouleversait
une grande planche en couleurs consacrée à Pierre Savorgnan de Brazza : dans
la brousse africaine, l'explorateur français vient d'arriver dans un
village de cases et libère des prisonniers promis à l'esclavage ; ses
aides débarrassent les malheureux des carcans faits de pièces de bois
liées autour de leur cou. Au centre de la scène, flotte un grand
drapeau français. Genou à terre, un Noir libéré, éperdu de
gratitude, étreint la main droite de Savorgnan de Brazza. Celui-ci le regarde
avec amitié et lui fait comprendre, en touchant de la main gauche le
drapeau tricolore que c'est la France qui est venue le sauver. Je ne
doutais à aucun moment que les peuples de l'empire colonial aient pour
notre pays amour et reconnaissance.
Ainsi
je me forgeais l'image d'une France rêvée, où se combinaient données
cartographiques, panoramas séduisants, terres exotiques, conquêtes héroïques
et actions généreuses. Cette patrie imaginée, l'école me donnait
envie de la connaître, de la comprendre, de l'aimer, de partager avec
elle sa grandeur et sa noblesse.
|
|
D'autres
outils pédagogiques me motivaient moins. Je n'étais pas très
courageux pour soutenir la vue de la planche, trop émotionnante pour ma
sensibilité, intitulée "Os,
muscles et nerfs" qui dévoilait l'anatomie du corps humain, un
squelette de face avec le
nom des os et un écorché de dos détaillant les muscles et les nerfs.
Je sus très tôt que j'étais trop impressionnable pour faire carrière
dans la médecine ! D'autres gravures pourtant plus neutres comme
"Les unités du système métrique" ou "Les plantes
utiles" ne me parlaient pas
davantage. Voir des betteraves et des
carottes ou bien un litre en fer blanc et un stère de bois m'ennuyait.
Je voulais du rêve et de l'inédit !
La
première leçon de géographie pour mon groupe de CE2 porta sur les mers et
océans. Aucun de nous n'avait jamais vu la mer, élément à peine
concevable pour de petits continentaux, et d'autant plus propice à
enflammer l'imagination. Subjugués, nous buvions les paroles du maître.
Il guida l'observation des cartes, fit répéter les noms des étendues
maritimes, parla de l'utilisation de la mer par les hommes et nous fit
frémir par des dictons suggestifs :" Qui voit Ouessant, voit son
sang, qui voit Sein, voit sa fin !" Curieusement, il termina la séquence
en nous précisant que l'eau de mer avait le goût du cacao. Personne ne
réagit à cette assertion étonnante, tout au plus ai-je cru percevoir
quelques tressaillements de rires contenus du côté des plus grands élèves
penchés sur d'autres travaux. Nous devions lire la page correspondante
du manuel pour la séquence de géographie suivante. Celle-ci commença
par une interrogation orale sur la première leçon. Force doigts pointés
vers le plafond attestaient que chacun avait à cœur de prouver qu'il
avait bien retenu les notions apprises. Et lorsque le maître posa enfin
la question "Quel est le goût de l'eau de mer ?", nous nous
battîmes pour être interrogés. Dès que le malheureux camarade désigné
par M. Liebmeister claironna :" L'eau de mer a le goût du cacao
!" toute la classe explosa de rire, hormis bien sûr les CE2 qui se
regardaient piteusement. M. Liebmeister rit de bon cœur, puis, le calme
revenu, nous adressa des paroles que je n'ai pas oubliées.
"Je
vous ai fait cette farce, dit-il, pour que vous reteniez qu'il ne faut
pas croire aveuglément ce que l'on vous dit, même ce que moi je vous
dis. Vous devez toujours vous demander si ce que vous entendez est
possible et raisonnable et, dans le doute, poser des questions,
rechercher la vérité et surtout vérifier dans des livres. Si vous
aviez étudié la page du manuel que je vous avais donnée à lire, vous
auriez appris que l'eau de mer est salée et vous ne seriez pas tombés
dans mon piège. A l'avenir, soyez des élèves fiers et vifs, aux yeux
et au cerveau bien ouverts et non des perroquets !"
Ces
mots me pénétrèrent et je sentis d'instinct qu'ils transformeraient
ma vie. Ils prenaient le contre-pied de la famille et de l'Église où
je devais obéir sans comprendre, répéter sans réfléchir, croire
sans voir. Dès mon premier âge, les rites religieux m'avaient
assujetti. A l'instant de l'élévation comme aux paroles du Tantum
Ergo, s'agenouiller servilement, baisser la tête, voire fermer les yeux étaient
devenus des réflexes et, répéter sans comprendre, mon pain
quotidien. Mais voilà qu'à l'école un adulte m'enjoignait, au
contraire, de me redresser, d'ouvrir mon esprit et d'exercer
mon jugement. Savorgnan de Brazza, sous l'égide du drapeau tricolore,
libérait l'Africain du carcan de l'esclavage. M. Liebmeister, en
m'instillant les prémices de l'esprit critique, amorçait mon émancipation
morale.
|