|
Chaque
confidence
créait dans mon esprit une vision d’horreur qui me poursuivrait. Les
nuits glaciales par - 40°, les baraques semi-enterrées où les
prisonniers s’entassaient sur les bat-flanc, la misérable pitance de
millet et de choux, la faim atroce de ces jeunes hommes moins nourris
qu’à Auschwitz, les ravages de la dysenterie, la tyrannie des chefs de
baraques dont une décision signifiait la vie ou la mort. Une scène
m’avait particulièrement horrifié : chaque matin, un groupe de
prisonniers enlevait les camarades morts pendant la nuit et, ne pouvant
pas creuser de fosse commune dans le sol gelé, empilait les cadavres dans
un hangar. L’évocation du séjour dantesque où cette multitude de
gisants attendaient le printemps me hanterait longtemps.
Les
récits hallucinants de Marcel nous communiquaient son exécration des
Russes dont la cruauté avait
remisé au second plan la barbarie nazie elle-même.
|
|
La
région Alsace, dans le cadre de sa politique de Mémoire, a
entrepris le recensement de toutes les victimes de la Seconde Guerre
mondiale et particulièrement des "Malgré-Nous."
En
février 2008, le
sénateur Philippe Richert, alors président du Conseil Général du
Bas-Rhin, a effectué un voyage à Tambov pour y rendre hommage aux
incorporés de force et promouvoir la coopération avec les autorités
locales pour l'entretien des lieux de mémoire et l'ouverture des archives
russes qui pourraient permettre aux familles de retrouver la trace de
leurs disparus.
Lors
de la cérémonie de commémoration et du dépôt de gerbes à Tambov-Rada,
M. Richert a donné lecture d’une lettre de Monsieur Nicolas Sarkozy,
premier président de la République à avoir reconnu le drame des
incorporés de force. Sa lettre est reproduite ci-contre.
Source : https://www.malgre-nous.eu/
|
|
Mesdames,
Messieurs,
Vous
êtes aujourd’hui rassemblés sur le site du Camp n°188 de
Tambov-Rada où dix-huit mille de nos compatriotes ont connu les
souffrances de la captivité.
Ici
moururent après avoir enduré le froid, la faim et la maladie, près
de cinq mille Alsaciens et Lorrains.
Je
m’associe aujourd’hui à votre recueillement et à l’hommage
que vous rendez à la mémoire de ces sacrifiés.
Ces
fils de France, en effet, sont morts parce qu’ils portaient un
uniforme qu’ils n’avaient pas choisi, incorporés contre leur gré
dans une armée qui n’était pas la leur.
Victimes
de l’Histoire, ils font pleinement partie de la communauté
nationale et c’est à ce titre que je m’incline aujourd’hui en
leur mémoire.
Ils
ne doivent pas être aspirés par l’oubli. Grâce à vous, leurs
noms figureront bientôt sur un monument érigé en Alsace-Moselle,
sur cette terre de France à laquelle ils ont été arrachés pour
être jetés dans ces combats acharnés.
Par
votre intermédiaire, je leur adresse aujourd’hui le salut
fraternel de la Nation à laquelle ils n’ont jamais cessé
d’appartenir.
Nicolas
Sarkozy
|
|
|
Maria et Stanislas, réfugiés polonais. (1945)
S’il
en avait été besoin, notre détestation des Russes aurait encore été renforcée
par nos voisins polonais, Maria et Stanislas. Déportés du travail par
les nazis, ce jeune couple avait échoué dans notre village où ils
avaient fondé un foyer égayé par trois enfants. Malgré leur allemand
approximatif, ils étaient bien acceptés par les villageois qui
estimaient leur discrétion et leur capacité de travail. Pourtant, un
seul projet absorbait tous leurs efforts : émigrer aux États-Unis.
Un jour qu’ils travaillaient avec nous à l’arrachage des pommes de
terre, j’entendis ma mère leur demander : "N’êtes-vous pas
bien, ici avec nous ? Pourquoi aller tout recommencer si loin ?" Et Stanislas de répondre : "Non, ici on est trop près des
Russes ; je ne serai tranquille que lorsqu’il y aura l’océan
entre eux et nous !" Je restai confondu par cette réponse qui
d’un coup me fit ressentir un danger que je n’imaginais pas si proche.
J’expérimentais sans les connaître les notions de péril rouge et de
guerre froide.
L’effroi
vis à vis des Russes était partagé par tous. Même entre enfants, nous
nous épouvantions en évoquant l’échéance fatale : "Wenn die
Rüssa komma !" *, qui s’ajoutait à la peur lancinante de la fin du monde
que nous instillait en permanence le clergé catholique. *
"Wenn die Russen kommen ! : Quand les Russes arriveront !"
D’autres
habitants du village dont le destin venait d’être bouleversé par la
guerre n’étaient pas en reste pour nous entretenir dans l’horreur des
Russes et des communistes.
|
|
Günther,
Arnold, Willy, Rudi, anciens
prisonniers allemands. (1945)
Günther,
Arnold, Willy, Rudi et d’autres, anciens soldats allemands prisonniers,
avaient préféré, une fois libérés, rester dans notre village plutôt
que de retourner dans leur pays natal à présent occupé par les Soviétiques.
Ils avaient fait souche ici ; à part quelques prénoms inusités
chez nous et des nuances de prononciation de leur parler, rien ne les
distinguait des Alsaciens. C’étaient nos voisins, nos compagnons de
travail dans les usines et les champs. Leurs enfants étaient mes
camarades à l’école, à l’église et dans les jeux. Je
m’interrogeais comment des gens à présent si proches avaient pu être
naguère des ennemis.
|
|
Léa
et Hilde, rapatriées
du Banat. (1948).
|
|
Deux
jeunes filles banataises, Léa et Hilde, s’étaient mariées récemment
avec des garçons de la commune.
En même temps que les villageois, je découvris les tribulations de ces
descendants d’Alsaciens chassés de leurs foyers par les communistes et
spoliés de tous leurs biens. Je comprenais difficilement comment ces
personnes aux patronymes familiers et s’exprimant dans un dialecte si
voisin du nôtre pouvaient venir de contrées aussi lointaines que la
Yougoslavie et la Roumanie. Source
: site "Banatportal" |
|

Le
Banat : région qui
s’étend sur la Roumanie, la Serbie et la Hongrie où s’étaient
installés au XVIIIe siècle des colons originaires d’Alsace, de
Lorraine, du Luxembourg et d’Allemagne. A la fin de 1948,
plusieurs milliers de descendants de ces colons qui avaient préservé
leur identité germanique, ont fui le communisme et sont revenus
vers les pays de leurs ancêtres. |
|
|
Le
procès de Bordeaux. (1953)
J’avais
à peine sept ans en février 1953 quand mon village et toute la région vécurent
des jours dramatiques. Ce dimanche après-midi, la tension qui montait ces
derniers jours de façon sourde chez les adultes éclata en crise ouverte.
Quand les cloches sonnèrent le tocsin, je partis pour l’église avec
mes parents. Je m’aperçus vite qu’il ne s’agissait pas des vêpres
banales qui n’attiraient qu’une modeste affluence. Non, de toutes les
maisons sortaient des familles entières au visage grave. Et, comportement
inhabituel, les gens s’interpellaient et se prenaient à témoin.
J’entendis : "C’est une honte !" "On ne peut pas
accepter cela !" "Il faut qu’ils comprennent !" "Pourquoi ce sont eux qui doivent payer ?"
Même mon père,
d’habitude si réservé, dit à un homme de son âge : "Comment
peuvent-ils les condamner alors qu’ils n’ont fait qu’obéir aux
ordres ?" |

Je savais par l’école
que ce qui se passait découlait de l’extermination, en juin 1944, de
plus de six cents habitants d’Oradour-sur-Glane par la division SS
"Das Reich." La sœur enseignante nous en avait fait une
description horrible, insistant particulièrement sur le massacre perpétré
dans l’église. Tandis que les hommes étaient fusillés à l’extérieur,
les femmes et les enfants furent entassés dans le sanctuaire. Les SS y
firent exploser un engin incendiaire qui libéra une fumée asphyxiante,
puis mirent le feu à des bottes de paille et des fagots, embrasant l’édifice
et immolant tous les occupants à l’exception d’une seule rescapée.
Ci-contre,
journal "ORADOUR SUR GLANE". Origine : site
"Histoire de Collection".
|
|
Plongés dans
l’atrocité de ces scènes, nous apprîmes avec effarement que parmi les
auteurs allemands de la tuerie se trouvaient des soldats alsaciens. Alors
que nous étions enclins à nous identifier aux victimes, voilà que nous
nous retrouvions dans le camp des coupables, à l’instar de ces quatorze
garçons de notre région qui venaient d’être condamnés par le
tribunal militaire de Bordeaux. La conjugaison de l’horreur et de la
culpabilité atterrait nos esprits enfantins.
Sur
le chemin de l’église, où un office spécial allait être célébré,
j’observais les adultes face à la tragédie. Je fus saisi par
l’unanimité de leur révolte et la force d’expression de leur incompréhension
et de leur rancœur. A l’unisson de toute l’Alsace, mon village
ressentait le verdict de Bordeaux comme un outrage et un déni inique du
droit. Chaque famille n’avait-elle pas un fils, un neveu, un cousin, un
voisin qui avait connu le même destin que les inculpés de Bordeaux ?
Parce que la France les avait abandonnés au vainqueur nazi, ils avaient
été enrôlés de force dans la Wehrmacht et pour beaucoup versés
d’office dans la Waffen-SS alors qu’ils n’avaient pas dix-huit ans.
Et maintenant cette même France condamnait ces garçons aux travaux forcés
pour crimes de guerre ! Chacun se sentit personnellement blessé par la
sentence d’autant plus révoltante que les officiers responsables du
massacre n’avaient pas pu être arrêtés et, que sur les vingt-et-un accusés présentés
au tribunal militaire, il n’y avait que sept Allemands pour quatorze
Alsaciens.
Huit
ans après son retour, la France risquait de s’aliéner l’Alsace. La
loi d’amnistie pour les incorporés de force votée quelques jours plus
tard évita la rupture mais ne referma pas de sitôt les plaies ouvertes
par le procès de Bordeaux. Je gardai de ce tragique épisode des sentiments
complexes : souffrance partagée avec la population alsacienne,
culpabilité et compassion envers les victimes du Limousin, mais aussi
exaltation de l’union et de la solidarité. Je ne devais jamais revoir
mes compatriotes unis dans une telle communion de pensée et d’action.
|

Oradour,
après l'incendie. |
|

Origine
des photos:
site :
"Oradour souviens-toi".
|
|
Récits
de la Première guerre mondiale.
Malgré
l’actualité brûlante des séquelles de la Seconde guerre mondiale, la
guerre 14-18 n’était pas tombée dans l’oubli. En laissant dix-huit
de ses enfants sur les champs de bataille, elle aussi avait saigné le
village et laissé dans les esprits des rescapés des traces indélébiles.
|
|
Ludwig
en Sibérie. (1914-1918)
Le
vieux Ludwig nous racontait ses aventures quand nous gardions les vaches
sur le Breuil.
Âgé de trente ans en
1914, il fut incorporé dès le début du conflit dans l’armée de
Guillaume II et dirigé sur le front de l’Est. Fait prisonnier par les
Russes, il vécut une incroyable odyssée dont il nous livrait des épisodes
picaresques. La Russie, alliée de la France dans le conflit, était censée
libérer les prisonniers alsaciens et les renvoyer en France. Mais le
chemin était long car il fallait traverser la Sibérie jusqu’au
Pacifique ! Voyage interminable entrecoupé de semaines, voire de mois
d’immobilisation où les hommes étaient astreints à des travaux forcés.
|

Prisonniers
alsaciens du secteur de Thann en Russie en 1916.
Photo
parue dans "Patrimoine Doller" n°5. Bulletin de la Société
d'Histoire de la Vallée de Masevaux, 1995.
|
|
Dans
mon esprit impressionnable se sont gravées des scènes liées à la faim,
au froid ou aux mœurs arriérées des Russes. Les prisonniers étaient
chroniquement sous-alimentés. Ainsi, lors d’une étape en train, la
ration du jour se limitait pour tout un wagon à une unique saucisse.
Ludwig nous interpella : "Comment pouvions-nous partager équitablement
cette saucisse entre une quarantaine d’hommes ?"
Il nous laissa languir quelques instants puis nous décrivit
comment la saucisse fut soigneusement vidée et diluée dans une marmite
d’eau chaude pour en faire un bouillon dont chaque homme put remplir son
quart. Parfois, les prisonniers devaient attendre, debout pendant des
heures par un froid glacial, que vienne un ordre, un appel ou une
affectation. Le froid sibérien était tel que le gel soudait les semelles
des sabots au sol. Seule solution : taper des pieds sur place sans
arrêt jusqu’à ce que vienne l’ordre de pouvoir se déplacer.
Régulièrement,
les prisonniers étaient affectés chez des paysans qu’ils aidaient dans
leurs travaux. Ludwig n’en revenait toujours pas que les Russes se
mettaient à genoux dans la litière souillée pour traire les vaches. Dès
qu’il fut chargé de la traite, il s’assit sur un seau retourné au
grand étonnement des paysans russes. Ludwig nous assura qu’après ce
geste révolutionnaire, il passa pour un génie aux yeux des moujiks !
Dans
ses narrations, Ludwig savait nuancer le tragique avec des anecdotes
pittoresques. Mais la péroraison en était toujours poignante. "J’ai
eu trois fils, aimait-il à nous rappeler. Je leur ai
souvent dit : Je préférerais conduire l’un de vous au cimetière
plutôt que de savoir qu’il doive endurer les mêmes épreuves que moi." Cependant, par pudeur, Ludwig nous taisait que le destin s’était avéré
encore plus impitoyable : lors du conflit suivant, son fils aîné
fut également incorporé de force en Russie et il n'en revint jamais.
|
Émile
en Ardèche. (1914-1918)
|
|
La maison du père
Émile se trouvait sur le chemin des champs ; il aimait bavarder avec
les passants et ne rechignait pas à livrer aux plus jeunes des péripéties
de sa jeunesse qui le rongeaient toujours. Âgé de dix-sept ans en 1914,
son grand crève-cœur avait été l’évacuation des hommes du Landsturm
*. Parti à
pied jusqu’à Bussang sous l’injonction de l’autorité militaire
occupante, il s’était retrouvé prisonnier de l’armée française qui
l’expédia à six cents kilomètres vers le sud, en Ardèche. Il gardait
de ce séjour forcé dans un camp de Vals-les-Bains un souvenir cuisant.
Dormant sur la paille, chichement nourri de soupe claire, l’ignorance
totale du français le murait dans
un monde hostile.
Quarante ans après, il souffrait encore de l’animosité
de la population locale : "Ils nous criaient : Salpoches
! invective
dont nous n’avons longtemps pas compris le sens ! Impossible pour eux de
faire la distinction entre nous et l’ennemi allemand, ni de supporter
que nous soyons là, loin des périls du front, alors que leurs maris, pères,
fils et frères côtoyaient journellement la mort." Émile
gardait une reconnaissance émue pour une dame de la Croix-Rouge suisse
qui visita son camp et lui donna un petit livre d’initiation au français.
|
|
*
L'évacuation
des hommes du Landsturm.
En
Allemagne, on appelait "Landsturm" le système de
défense du territoire dont relevaient en temps de guerre tous les hommes de 17 à 45 ans.
Dans l'Alsace d'avant 1914, terre d'empire, les hommes de cet âge
étaient également assujettis à cette obligation militaire.
Dès
le 2 août 1914, la plupart des hommes de 21 à 36 ans furent
mobilisés dans l'armée allemande et quittèrent notre vallée,
principalement pour le front russe.
Le
7 août 1914, l'armée française occupa nos villages. Elle décida d'évacuer les hommes
relevant du Landsturm qui s'y trouvaient encore pour éviter qu’ils ne soient mobilisés par l’Allemagne dans
le cas où l’armée française devrait se retirer de ses conquêtes.
Ainsi
ne restaient dans les familles que les femmes, les enfants et les
hommes âgés. L'essentiel de la population active, celle qui
rapportait un salaire de l'usine ou exécutait les travaux de
force manquait cruellement. |
|
|
"Ce
livre m’a sauvé, répétait-il ; aujourd’hui encore, je le
connais par cœur. Grâce à lui, j’ai pu enfin m’ouvrir à mon
entourage et comprendre ce qui se passait."
Les
autorités pressaient les jeunes internés de s’engager dans l’armée
française. Pour Émile, c’était impensable : comment aurait-il pu
aller combattre l’armée où servaient les membres de sa famille et ses
concitoyens alsaciens ? Les recruteurs avaient beau promettre que les engagés
seraient envoyés en Afrique du Nord et non sur le front, Émile ne leur
faisait pas confiance. Ayant refusé de s’engager, n’ayant pas pu
obtenir un rapatriement au titre d’un emploi dans une usine
d’armement, Émile resta dans le midi de la France jusqu’à
l’armistice. Il en revint définitivement ulcéré par la France. Désormais
son vocabulaire alsacien s’était enrichi d’une expression nouvelle.
Quand il voulait dire qu’un jeune avait la vie dure, il disait :
"Da Junga hàt Ardèche !" *
* "Dieser
Junge hat Ardèche ! : Ce
garçon subit le régime de l’Ardèche."
|
|

Les
évacués du Landsturm de mon village à Vals-les-Bains en décembre 1914.
Premier debout à partir de la gauche : mon grand-père maternel, Robert
Lévêque. A côté de lui, ses deux frères.
Photo de
famille. |









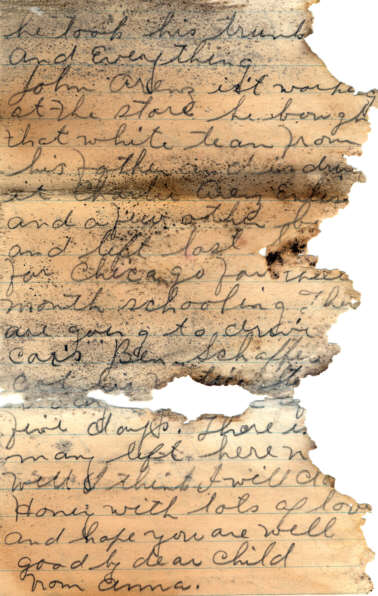 Un jour mon père entreprit de changer par l’intérieur une tuile abîmée
du fenil. En ôtant l’épaisse couche de poussière de foin et de toiles
d’araignées qui tapissait le toit, il mit au jour, coincée entre
lattes et tuiles, une liasse de papier qui se décomposa en partie quand
elle fut prise en main. Mon père la mit de côté et poursuivit son
travail. J’étais près de lui pour lui tendre outils ou matériel mais
mon esprit fantasmait sur notre découverte. Que pouvaient-être ces
parchemins ? Je balançais entre le plan d’un trésor et le
testament secret d’un illustre ancêtre. En dépliant les feuilles, nous
constatâmes qu’il s’agissait de lettres manuscrites écrites en
anglais. Bien qu’ignorant tout de cette langue, je scrutai tant et si bien
les fragments encore lisibles que j’en discernai la nature.
Un jour mon père entreprit de changer par l’intérieur une tuile abîmée
du fenil. En ôtant l’épaisse couche de poussière de foin et de toiles
d’araignées qui tapissait le toit, il mit au jour, coincée entre
lattes et tuiles, une liasse de papier qui se décomposa en partie quand
elle fut prise en main. Mon père la mit de côté et poursuivit son
travail. J’étais près de lui pour lui tendre outils ou matériel mais
mon esprit fantasmait sur notre découverte. Que pouvaient-être ces
parchemins ? Je balançais entre le plan d’un trésor et le
testament secret d’un illustre ancêtre. En dépliant les feuilles, nous
constatâmes qu’il s’agissait de lettres manuscrites écrites en
anglais. Bien qu’ignorant tout de cette langue, je scrutai tant et si bien
les fragments encore lisibles que j’en discernai la nature.
